Mettons fin à la pandémie du VIH/SIDA en protégeant les droits humains
À l’approche de la Journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée chaque 1er décembre, l’ONUSIDA rappelle que la fin de cette pandémie est à portée de main d’ici 2030. Toutefois, cet objectif ambitieux ne sera réalisable que si les droits humains deviennent une priorité dans les efforts de lutte contre le VIH/SIDA. Son rapport, intitulé « Suivons le chemin des droits pour mettre fin au sida », souligne l’importance de l’inclusion et de la justice sociale pour améliorer la santé publique.
Les droits humains au cœur de la riposte au VIH/SIDA
Pour atteindre cet objectif, il est crucial de reconnaître les défis encore présents. Bien que des progrès notables aient été réalisés, les discriminations persistantes empêchent encore des millions de personnes vivant avec le VIH d’accéder aux soins. Selon l’ONUSIDA, sur les 39,9 millions de personnes vivant avec le virus, 9,3 millions n’ont pas encore accès aux traitements salvateurs. Par ailleurs, en 2023, 630 000 décès liés au sida ont été enregistrés, et 1,3 million de nouvelles infections ont été recensées.
Ces données alarmantes mettent en évidence l’impact des inégalités sociales sur l’accès aux soins, comme l’a souligné Winnie Byanyima, directrice exécutive de l’ONUSIDA :
« Lorsque des barrières sociales ou juridiques empêchent l’accès aux soins, cela coûte des vies. Protéger les droits de tous est essentiel pour garantir la santé de chacun. »
Les femmes et les filles, particulièrement vulnérables
L’injustice de genre est l’un des obstacles les plus flagrants à surmonter dans cette lutte. En Afrique subsaharienne, les jeunes filles et femmes de 15 à 24 ans représentent une proportion alarmante des nouvelles infections. En 2023, chaque jour, 570 jeunes femmes ont contracté le VIH. Elles sont trois fois plus exposées que les hommes du même âge, en raison de facteurs comme l’inégalité de genre et le manque d’accès à l’éducation.
Ce constat est appuyé par des témoignages poignants, comme celui de Nomonde Ngema, militante de 21 ans :
« L’éducation et l’information sont des boucliers contre le VIH. Aucune fille ne devrait en être privée. La violence et la discrimination doivent cesser. »
Il conviendrait, avant d’aborder la réponse mise en place par les Etats, de rappeler les différents facteurs de risque d’infection par la VIH. L’OMS liste les facteurs décrits ci-dessous:
- Rapports anaux ou vaginaux non protégés ;
- Présence d’une autre infection sexuellement transmissible (IST) : syphilis, herpès, chlamydiose, gonorrhée ou vaginose bactérienne ;
- Comportements sexuels liés à l’usage nocif d’alcool ou de drogues ;
- Partage de matériel d’injection : aiguilles, seringues ou solutions contaminées ;
- Injections, transfusions sanguines, ou greffes de tissus effectuées dans des conditions non stériles ;
- Piqûres accidentelles d’aiguille, notamment chez les agents de santé.
Au Togo : une réponse organisée pour tous
Face à ces réalités, des pays comme le Togo s’efforcent de renforcer leur réponse nationale. Le Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS) coordonne les efforts de prévention, de diagnostic et de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Les actions menées dans ce sens sont orientées vers trois grands axes décrits comme suit:
- Prophylaxie et prévention : Le Togo met à disposition la prophylaxie pré-exposition (PrEP) pour les populations à risque, notamment les travailleuses du sexe et les homosexuels . Des campagnes de sensibilisation visent aussi à promouvoir l’usage du préservatif et le dépistage volontaire.
- Diagnostic biologique : Le dépistage est accessible gratuitement dans de nombreux centres de santé et lors des campagnes communautaires. Les tests de charge virale, essentiels pour suivre l’efficacité des traitements, sont désormais disponibles dans des laboratoires régionaux.
- Prise en charge médicale : Les antirétroviraux (ARV) sont fournis gratuitement grâce aux efforts du PNLS et des partenaires internationaux. Des cliniques spécialisées, appelées unités de prise en charge intégrée (UPCI), offrent des services complets, incluant le conseil psychosocial.
Ces initiatives témoignent d’un engagement fort, mais des défis comme la stigmatisation persistent. Selon le PNLS, des campagnes de sensibilisation à grande échelle sont nécessaires pour briser les tabous dans les communautés et les écoles.
Lutter contre les discriminations pour sauver des vies
Ces efforts nationaux doivent s’accompagner de réformes globales. Les lois criminalisant certaines communautés marginalisées, encore présentes dans de nombreux pays, sont un frein à l’accès aux soins. Axel Bautista, de MPact Global Action, avertit :
« Les gouvernements doivent cesser de marginaliser pour garantir un accès universel aux services de prévention et de traitement du VIH. »
L’innovation scientifique au service de l’équité
Un vent d’espoir souffle avec les innovations scientifiques. Les traitements à longue durée d’action, nécessitant seulement quelques injections par an, sont une avancée majeure. Mais leur accessibilité dépend de politiques inclusives. Alexandra Calmy, spécialiste du VIH, appelle à des efforts mondiaux pour réduire leur coût et les rendre disponibles partout :
« Ces innovations ne doivent pas être réservées à quelques-uns. »
L’infection au VIH est évitable. On peut réduire le risque avec les démarches de prévention suivantes :
- l’utilisation du préservatif masculin ou féminin pendant les rapports sexuels ;
- le dépistage du VIH et d’autres infections sexuellement transmissibles ;
- la circoncision masculine médicale volontaire ; et
- les services de réduction des effets nocifs pour les consommateurs de drogues par injection
Les médecins peuvent suggérer des médicaments et des dispositifs médicaux pour aider à prévenir le VIH, notamment :
- les antirétroviraux, y compris la prophylaxie préexposition par voie orale et les produits à longue durée d’action ;
- les anneaux vaginaux de dapivirine ;
- et le cabotégravir injectable à longue durée d’action.
Les antirétroviraux peuvent également être utilisés pour empêcher la transmission mère-enfant du VIH.
Un appel à l’action collective
Pour concrétiser ces ambitions, la mobilisation de chacun est essentielle. Le Togo, à travers le PNLS, réitère son engagement à atteindre l’objectif « Zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès lié au sida ». En cette Journée mondiale de lutte contre le sida, chaque citoyen est invité à agir : se protéger, se faire dépister, et soutenir ceux qui vivent avec le VIH.
C’est pourquoi, Das Labor. Togo soutient cette dynamique en mettant au service de la population et des collectivités toutes les ressources nécessaires au diagnostic biologique du VIH.
Protéger les droits humains, c’est sauver des vies. Ensemble, mettons fin à la pandémie.
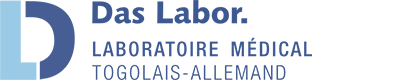
Super, ensemble mettons fin à la pandémie du VIH SIDA
Merci pour les conseils prodigués